« Il n’y a pas qu’au Danemark… »
J’ai dit au sujet d’Allain Leprest qu’on risquait d’assister bientôt au bal traditionnel des faux-culs, à l’expression d’hommages posthumes émanant d’individus qui s’étaient consciencieusement appliqués à l’ignorer de son vivant. Ça n’a pas manqué ! Mais cette ronde des hypocrites sévit dans tous les domaines : on voudrait par exemple nous faire croire qu’on découvre aujourd’hui seulement, plus de cinquante ans après « le temps des colonies », les méthodes maffieuses de la Françafrique… Petit intermède d’actualité, si ça vous chante, à propos de ce que le journaliste d’investigation Pierre Péan appelle La République des mallettes dans son nouveau livre. À la barre des témoins, en paroles et musiques : Pierre Akendengué, Francis Bebey et Leny Escudero.

Des chefs d’États africains auraient contribué à financer certaines de nos campagnes présidentielles ? « Que dites-vous là ? » Des valises pleines de billets auraient transité, des années durant, de Libreville, Abidjan, Dakar ou Brazzaville à Paris ? « Quelle imagination ! » On aurait utilisé de l’argent détourné – l’argent extorqué aux peuples africains, l’argent du développement – pour payer les campagnes présidentielles de certains partis français ? « Pas possible ?! » Eh bien oui, c’est possible.. comme est bien réparti, aussi, l’art consommé de la comédie dans le monde politicien.
On fait semblant de tomber des nues, alors que tout observateur un tant soit peu informé du fonctionnement de la Françafrique sait, ne serait-ce que par ses lectures, que ces pratiques n’ont pas tardé à se mettre en place après les indépendances des années 60 et qu’elles étaient devenues monnaie courante – c’est le cas de le dire – dès les années 70. Des preuves ? Comme vient de le dire un de ces « éminents » porteurs de valises, d’un président l’autre, le propre de ce système était de ne pas laisser de trace. La seule nouveauté dans cette affaire, c’est précisément qu’un de ces hommes de l’ombre, adoubé en France comme en Afrique, ait décidé de vendre la mèche. Pourquoi ? Et pourquoi maintenant ? Amertume d’avoir été mis à l’écart et vengeance consécutive ? Menaces indirectes ? Conscience à soulager ? On laissera à la justice, puisqu’elle est saisie, le soin d’en juger.
Une chose est sûre : il s’agissait depuis longtemps d’un secret de polichinelle pour les médias, les hommes de pouvoir et les partis politiques. Alors, les cris d’orfraie entendus ces jours derniers, les cris de surprise et d’indignation, n’en croyez rien. De là à dire que tout le monde en a croqué, que tout le monde est compromis, il y a un grand pas qu’il faut se garder de franchir. En revanche, comme l’écrivait en 1978 Leny Escudero dans Sacco et l’autre, il est certain qu’« il n’y a pas qu’au Danemark / Que quelque chose soit pourri ». Souvenir personnel : cette chanson provoqua un long délire d’applaudissements doublé de manifestations d’enthousiasme, au moment où l’artiste, se produisant un soir de la fin des années 70 sur le continent noir, lança ces couplets : « Patrice Lumumba / L’Afrique a émigré / Paris paye ses bras / Pour se faire une beauté / Tes frères de Soweto / Meurent en criant ton nom / Que tu es mort trop tôt / Et que l’Afrique est en prison… » J’en frissonne encore.
Pour avoir vécu une première vie de journaliste d’information générale en Afrique de l’Ouest puis de l’Est (voir « En guise de prologue » dans ce blog), je peux témoigner de ces pratiques, largement connues et reconnues, et d’autres encore que nous dénoncions déjà, ma chère et tendre et moi, au milieu des années 70 : cela nous valut d’ailleurs, naïfs (et jeunes !) que nous étions, d’être finalement déclarés persona non grata dans un pays dont nous nous considérions pourtant citoyens d’adoption et pour le développement duquel nous nous battions sans rechigner à la tâche. C’était sans… compter sur les forces de corruption au service de la Françafrique ; sans les porteurs de valises (ouh ! les vilains…) que d’aucuns (ouh ! les menteurs…) prétendent découvrir aujourd’hui.
On ne refait pas l’histoire, mais au moins peut-on saluer ceux qui n’étaient pas dupes et tentaient chacun à sa façon, et souvent à leurs risques et périls, d’éveiller les consciences. Parmi ceux-ci, deux grands artistes, auteurs-compositeurs-interprètes, deux voix intègres qui, bien que peu diffusées en France par le passé et encore moins (voire plus du tout) aujourd’hui, font partie du panthéon de la chanson africaine. Quelque part entre Brassens et Atahualpa Yupanqui pour le premier, entre Pierre Perret (ou Bourvil) et Narciso Yepes (ou Andres Segovia) pour le second.
D’abord la voix « considérable » (titre d’une de ses plus belles chansons) du Gabonais Pierre Akendengué, que nous eûmes la chance de découvrir à Libreville trois ans avant la sortie de son premier album (Nandipo, chez Saravah) : c’était il y a quarante ans, en 1971… Trente-quatre ans plus tard, dans un album intitulé Gorée (« L’Europe a organisé la traite des esclaves et les rois et les chefs africains l’ont alimentée », écrit-il comme une métaphore de la Françafrique, « d’où, de part et d’autre, la nécessité d’un travail de mémoire et d’un devoir de vigilance »), la chanson ci-dessus témoigne de la fidélité du poète, alors âgé de 62 ans, à ses idéaux. Son titre ? Békélia, c’est-à-dire « Espérance »…
Ensuite la voix, tendre et malicieuse tour à tour, du Camerounais Francis Bebey qui nous honora de son amitié et nous manque chaque jour davantage depuis qu’il s’en est allé rejoindre ses ancêtres (Ah ! si les Gaulois avaient su…), il y a dix ans, le 28 mai 2001.
Francis Bebey dont il faudra bien, un jour ou l’autre, reconnaître le génie artistique ; d’auteur et de compositeur bien sûr – et pas seulement de chansons (il mena une admirable carrière parallèle d’écrivain et de concertiste international) – mais aussi d’humaniste pétri d’humour et de bon sens, comme l’illustre l’une de ses ultimes créations (Le Nacapella, 1997), histoire de mallette avant l’heure : « Le père nous a raconté aussi / L’histoire de l’homme qui était parti / En emportant avec lui / La caisse du pays / Tout le monde se lamentait / Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest / En accusant le bonhomme / Comme s’il avait emporté avec lui / Le pays tout entier dans la caisse / Alors que la vraie caisse du pays était restée là : / C’est la population et le travail que fait / Chaque citoyen chaque jour dans son propre domaine… »

Une petite dernière, encore, pour la route (et le bonheur de réécouter Francis Bebey) : ce délicieux Travail au noir d’un Noir d’ébène accusé de faire travailler des Blanches au noir… « Quand on aura vu ça / On aura vraiment tout vu / Après ça y aura plus rien à voir. » Pas même les valises baladeuses d’argent blanchi, puisque renvoyées à un passé révolu ; forcément révolu, vu la morale stricte régissant aujourd’hui les règles économico-libéro-politiques de la mondialisation...

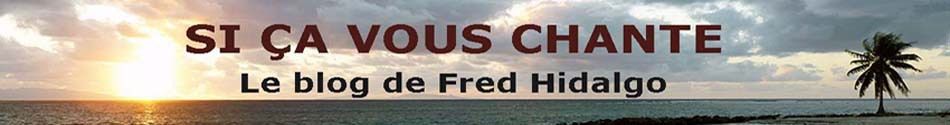
/image%2F1490260%2F20221111%2Fob_43f924_banniere11112022.gif)
